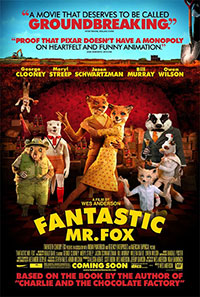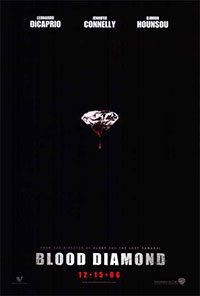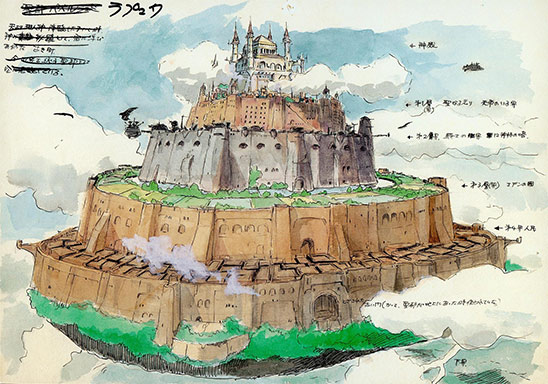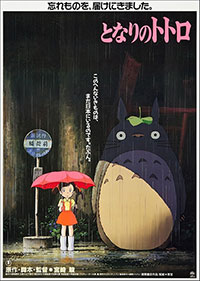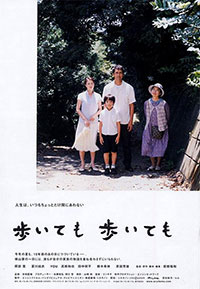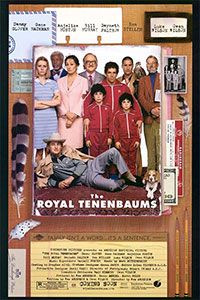Titre original : « Zai na he pan qing cao qing »
 Taïwan. Un jeune homme arrive de la grande ville dans un petit village isolé pour remplacer l’une des institutrices de l’école. Son arrivée apporte un souffle d’air frais et une relation discrète commence à se nouer entre lui et une jolie institutrice… Green Green Grass of Home, titre parfois traduit en français par L’herbe verte de chez nous, est le troisième film du réalisateur taiwanais Hou Hsiao-hsien. Comme pour les deux précédents, il s’agit d’un film destiné à mettre en valeur le chanteur de pop taïwanaise Kenny Bee. Ce dernier a une nouvelle partenaire, Chiang Ling, qui est on peut plus charmante. L’histoire est très convenue, gentillette même, d’un intérêt assez faible. En faisant preuve d’un peu plus d’indulgence, on peut s’intéresser au portrait d’un petit village qui vit près de la nature mais ce portrait paraît passablement édulcoré. Ces trois premiers films ont certainement permis à Hou Hsiao-hsien de trouver son style puisqu’il a eu envie de faire ensuite des choses différentes.
Taïwan. Un jeune homme arrive de la grande ville dans un petit village isolé pour remplacer l’une des institutrices de l’école. Son arrivée apporte un souffle d’air frais et une relation discrète commence à se nouer entre lui et une jolie institutrice… Green Green Grass of Home, titre parfois traduit en français par L’herbe verte de chez nous, est le troisième film du réalisateur taiwanais Hou Hsiao-hsien. Comme pour les deux précédents, il s’agit d’un film destiné à mettre en valeur le chanteur de pop taïwanaise Kenny Bee. Ce dernier a une nouvelle partenaire, Chiang Ling, qui est on peut plus charmante. L’histoire est très convenue, gentillette même, d’un intérêt assez faible. En faisant preuve d’un peu plus d’indulgence, on peut s’intéresser au portrait d’un petit village qui vit près de la nature mais ce portrait paraît passablement édulcoré. Ces trois premiers films ont certainement permis à Hou Hsiao-hsien de trouver son style puisqu’il a eu envie de faire ensuite des choses différentes.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Kenny Bee, Chiang Ling
Voir la fiche du film et la filmographie de Hou Hsiao-hsien sur le site IMDB.
Voir les autres films de Hou Hsiao-hsien chroniqués sur ce blog…
Remarque :
* Hou Hsiao-hsien a en quelque sorte renié ses trois premiers films, affirmant qu’il avait débuté sa carrière avec Les Garçons de Fengkuei en 1983.

Kenny Bee et Chiang Ling dans L’herbe verte de chez nous de Hsiao-Hsien Hou.