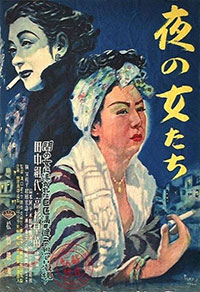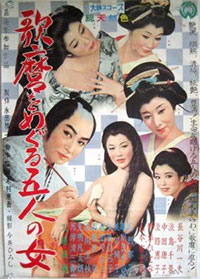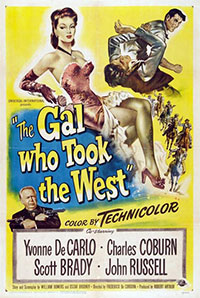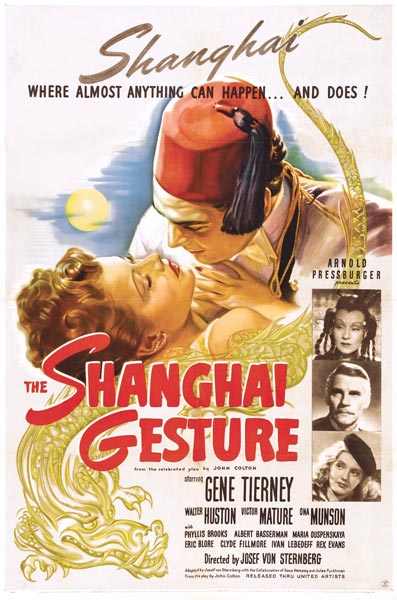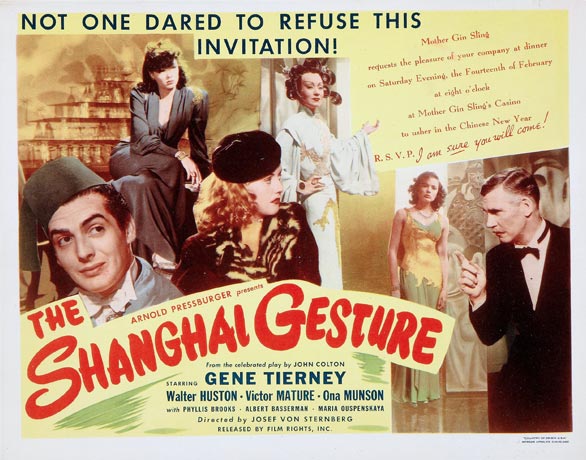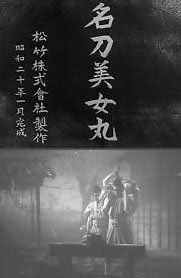Titre original : « They Live by Night »
 Le jeune Bowie vient de s’évader de prison avec deux complices. Il tombe amoureux de Keechie, la nièce de l’un deux chez qui ils se sont réfugiés. Après un cambriolage de banque, commence une cavale sans fin… Les amants de la nuit est adapté d’un roman d’Edward Anderson « Thieves like us ». C’est le premier film de Nicholas Ray qui a bénéficié d’une grande autonomie sur le tournage et a pu se livrer à quelques expérimentations. Si le film peut évidemment être classé parmi les films noirs, c’est aussi et surtout une histoire d’amour, celle de deux êtres qui ne peuvent trouver leur place dans la société (on apprend très tôt dans le film que Bowie n’a au départ rien d’un gangster et qu’il a été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis). Ils sont condamnés à errer malgré leur très forte envie de s’établir et mener une vie normale. La grande réussite du film est dans son atmosphère, sombre, distillant une certaine claustrophobie qui nous fait partager les sentiments du jeune couple. Farley Granger et Cathy O’Donnell sont très touchants, montrant beaucoup de naïveté et de vulnérabilité. Les amants de la nuit est un très beau film, très personnel aussi. Tourné en 1947, le film est resté deux ans dans les tiroirs de la RKO. Quand il a fini par sortir, il n’a pas vraiment été bien reçu sauf en Europe.
Le jeune Bowie vient de s’évader de prison avec deux complices. Il tombe amoureux de Keechie, la nièce de l’un deux chez qui ils se sont réfugiés. Après un cambriolage de banque, commence une cavale sans fin… Les amants de la nuit est adapté d’un roman d’Edward Anderson « Thieves like us ». C’est le premier film de Nicholas Ray qui a bénéficié d’une grande autonomie sur le tournage et a pu se livrer à quelques expérimentations. Si le film peut évidemment être classé parmi les films noirs, c’est aussi et surtout une histoire d’amour, celle de deux êtres qui ne peuvent trouver leur place dans la société (on apprend très tôt dans le film que Bowie n’a au départ rien d’un gangster et qu’il a été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis). Ils sont condamnés à errer malgré leur très forte envie de s’établir et mener une vie normale. La grande réussite du film est dans son atmosphère, sombre, distillant une certaine claustrophobie qui nous fait partager les sentiments du jeune couple. Farley Granger et Cathy O’Donnell sont très touchants, montrant beaucoup de naïveté et de vulnérabilité. Les amants de la nuit est un très beau film, très personnel aussi. Tourné en 1947, le film est resté deux ans dans les tiroirs de la RKO. Quand il a fini par sortir, il n’a pas vraiment été bien reçu sauf en Europe.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Farley Granger, Cathy O’Donnell, Howard Da Silva, Jay C. Flippen
Voir la fiche du film et la filmographie de Nicholas Ray sur le site IMDB.
Voir les autres films de Nicholas Ray chroniqués sur ce blog…
Remarque :
They Live by Night a été souvent rapproché d’autres films sur des couples en cavale, des rapprochements aussi superficiels qu’inutiles. Le film de Nicholas Ray est ainsi très différent de You only live once (1937) de Fitz Lang, il est encore plus différent de Gun Crazy de Joseph H. Lewis (1950). Dire qu’il préfigure Bonnie & Clyde d’Arthur Penn (1967) est une affirmation vraiment incompréhensible. Ces trois films sont toutefois de grande valeur et c’est sans doute là leur plus principal point commun avec They Live by Night !
Remake :
Nous sommes tous des voleurs (Thieves like us) de Robert Altman (1974) avec Keith Carradine et Shelley Duvall.