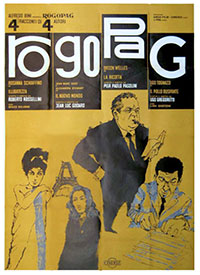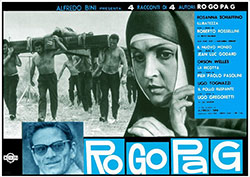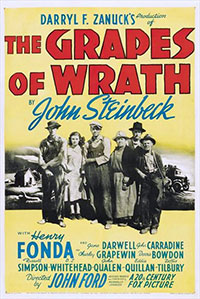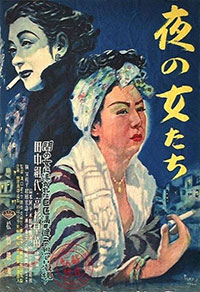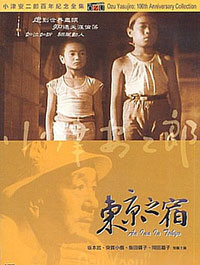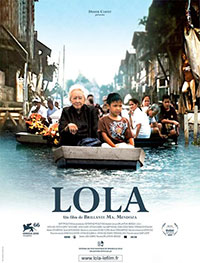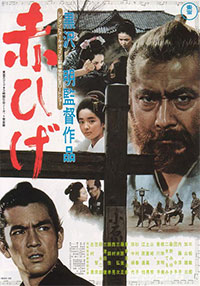A la mort de sa grand-mère, la jeune Lydia se retrouve orpheline. Elle a bien du mal à continuer ses études de droit et accumule les dettes. Sa seule amie lui conseille de se faire passer pour la fille naturelle d’un écrivain connu. Elle refuse tout d’abord mais ne pouvant trouver de travail, elle finit par accepter… Abus de confiance est le deuxième film d’Henri Decoin avec sa jeune épouse Danielle Darrieux, alors âgée de 20 ans. Plus que l’intrigue, c’est la condition sociale de cette étudiante sans le sou qui a visiblement intéressé Decoin. Il nous la montre très vulnérable, en proie à tous les profiteurs libidineux qui tentent d’abuser d’elle. Il veut nous montrer qu’elle est presque forcée d’en venir à l’escroquerie… Le final est de toute beauté avec une plaidoirie magistrale de la jeune avocate contre la pauvreté. Abus de confiance est finalement un film très humaniste. La réalisation d’Henri Decoin est assez classique, sans grand éclat mais il sait nous gratifier de quelques très beaux gros plans de son actrice préférée.
A la mort de sa grand-mère, la jeune Lydia se retrouve orpheline. Elle a bien du mal à continuer ses études de droit et accumule les dettes. Sa seule amie lui conseille de se faire passer pour la fille naturelle d’un écrivain connu. Elle refuse tout d’abord mais ne pouvant trouver de travail, elle finit par accepter… Abus de confiance est le deuxième film d’Henri Decoin avec sa jeune épouse Danielle Darrieux, alors âgée de 20 ans. Plus que l’intrigue, c’est la condition sociale de cette étudiante sans le sou qui a visiblement intéressé Decoin. Il nous la montre très vulnérable, en proie à tous les profiteurs libidineux qui tentent d’abuser d’elle. Il veut nous montrer qu’elle est presque forcée d’en venir à l’escroquerie… Le final est de toute beauté avec une plaidoirie magistrale de la jeune avocate contre la pauvreté. Abus de confiance est finalement un film très humaniste. La réalisation d’Henri Decoin est assez classique, sans grand éclat mais il sait nous gratifier de quelques très beaux gros plans de son actrice préférée.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Danielle Darrieux, Charles Vanel, Valentine Tessier, Pierre Mingand
Voir la fiche du film et la filmographie de Henri Decoin sur le site IMDB.
Voir les autres films de Henri Decoin chroniqués sur ce blog…
Voir les livres sur Henri Decoin…
Remarques :
* L’histoire est de Pierre Wolff qui a également écrit les dialogues. L’adaptation a été écrite par Henri Decoin et Jean Boyer.
* Comme l’a fait remarquer de façon amusante le critique d’un magazine bien connu, la silhouette de Danielle Darrieux qui déambule dans les rues avec son grand ciré noir n’est pas sans faire penser à celle de Michelle Morgan de Quai des Brumes que Carné tournera l’année suivante… Le ciré noir était (a toujours été ?) assez prisé des cinéastes car très photogénique. On pourrait citer aussi comme exemple Simone Simon dans La Bête humaine de Renoir, tourné également l’année suivante.