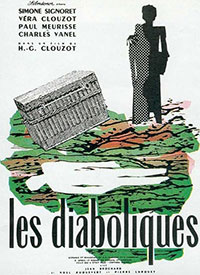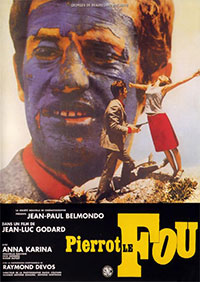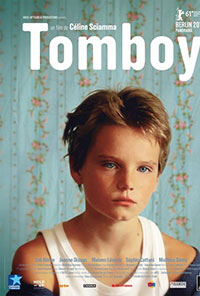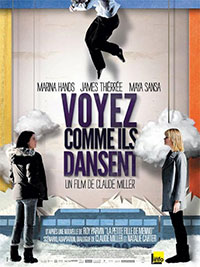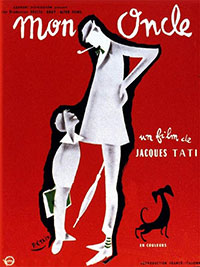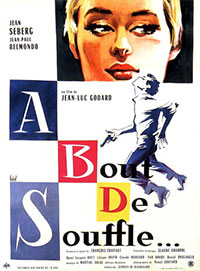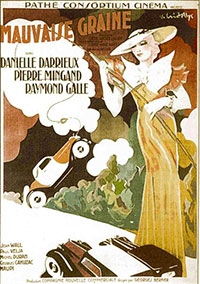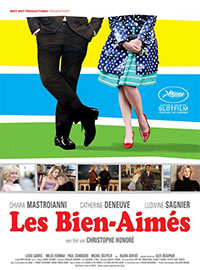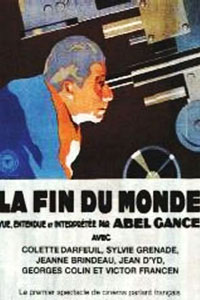 Jean, acteur, écrivain et poète, et son frère Martial, astronome nobélisé, sont amoureux de la même femme. Jean veut se retirer pour son frère qui refuse ce sacrifice. Martial découvre qu’une comète va heurter la terre dans 114 jours. La panique s’empare de la population. Martial parvient à faire proclamer la République Universelle… La fin du monde est le premier film parlant d’Abel Gance. Après La Roue et Napoléon, le réalisateur se lance à nouveau dans une très grande fresque prévue pour durer trois heures. Il y tient lui-même le rôle principal. Hélas, malgré tout le génie qu’il a pu montrer dans ses productions en cinéma muet, Abel Gance ne parvient pas à maitriser le parlant dès cette première production : le jeu des acteurs est épouvantablement théâtral.
Jean, acteur, écrivain et poète, et son frère Martial, astronome nobélisé, sont amoureux de la même femme. Jean veut se retirer pour son frère qui refuse ce sacrifice. Martial découvre qu’une comète va heurter la terre dans 114 jours. La panique s’empare de la population. Martial parvient à faire proclamer la République Universelle… La fin du monde est le premier film parlant d’Abel Gance. Après La Roue et Napoléon, le réalisateur se lance à nouveau dans une très grande fresque prévue pour durer trois heures. Il y tient lui-même le rôle principal. Hélas, malgré tout le génie qu’il a pu montrer dans ses productions en cinéma muet, Abel Gance ne parvient pas à maitriser le parlant dès cette première production : le jeu des acteurs est épouvantablement théâtral. 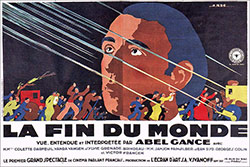 De plus, le scénario fait montre d’une naïveté presque puérile et s’empêtre dans le romanesque et dans un essai de créer un Christ moderne. Le film sera amputé de moitié avant même sa sortie et c’est donc une version de 105 minutes qui sera commercialisée. La fin du monde reste toutefois intéressant à visualiser car il témoigne des ambitions d’Abel Gance, véritable auteur de cinéma.
De plus, le scénario fait montre d’une naïveté presque puérile et s’empêtre dans le romanesque et dans un essai de créer un Christ moderne. Le film sera amputé de moitié avant même sa sortie et c’est donc une version de 105 minutes qui sera commercialisée. La fin du monde reste toutefois intéressant à visualiser car il témoigne des ambitions d’Abel Gance, véritable auteur de cinéma.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Abel Gance, Colette Darfeuil, Victor Francen
Voir la fiche du film et la filmographie de Abel Gance sur le site IMDB.
Voir les autres films de Abel Gance chroniqués sur ce blog…
Remarque :
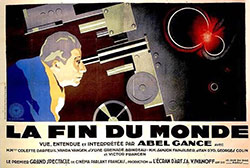 Après une projection en 1964, Abel Gance déclarera : « C’est un désastre. Je trouve tout le film exécrable, le jeu des acteurs, moi compris, ridicule, le sujet invraisemblable. Quelques séquences peuvent servir d’extraits de cinémathèque, et encore ! » (cité dans Abel Gance par Roger Icart, Ed. L’âge d’homme).
Après une projection en 1964, Abel Gance déclarera : « C’est un désastre. Je trouve tout le film exécrable, le jeu des acteurs, moi compris, ridicule, le sujet invraisemblable. Quelques séquences peuvent servir d’extraits de cinémathèque, et encore ! » (cité dans Abel Gance par Roger Icart, Ed. L’âge d’homme).