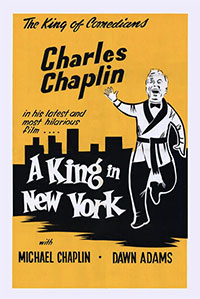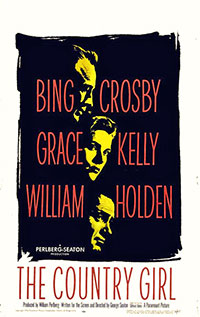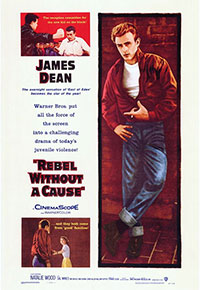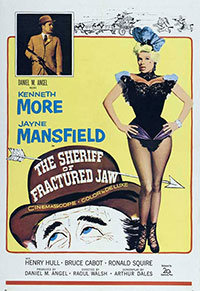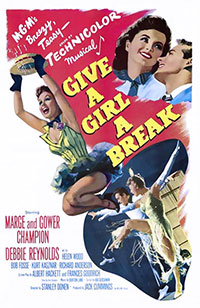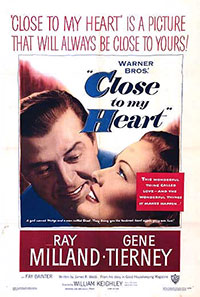Titre original : « Die Brücke »
 En 1945, dans une Allemagne proche de la capitulation, des jeunes garçons de 15-16 ans fréquentent l’école d’une petite ville. Alors qu’une certaine résignation s’est répandue dans la population, les adolescents sont toujours exaltés et espèrent être mobilisés pour aller, eux aussi, défendre leur patrie. Leur voeu va hélas être exaucé lorsque l’état-major décide de lancer toutes ses forces valides dans un dernier sursaut… Le pont est basé sur un roman de Manfred Gregor, le seul survivant des évènements racontés ici (1). C’est un film qui démontre l’absurdité de la guerre et, surtout, qui dénonce l’endoctrinement de la jeunesse. Tout d’abord, nous voyons évoluer ces adolescents dans leurs jeux, leur éveil à l’amour ; nous pouvons constater à quel point les exhortations à montrer sa valeur, son courage trouvaient là un terrain propice, les jeunes garçons ne pouvant s’empêcher d’idéaliser la guerre. Le jeu des acteurs est très naturel et donne une grande authenticité au film de Bernhard Wicki. La démonstration est terriblement efficace. Couvert de récompenses outre-Rhin, Le pont a été montré à toute une génération d’écoliers allemands.
En 1945, dans une Allemagne proche de la capitulation, des jeunes garçons de 15-16 ans fréquentent l’école d’une petite ville. Alors qu’une certaine résignation s’est répandue dans la population, les adolescents sont toujours exaltés et espèrent être mobilisés pour aller, eux aussi, défendre leur patrie. Leur voeu va hélas être exaucé lorsque l’état-major décide de lancer toutes ses forces valides dans un dernier sursaut… Le pont est basé sur un roman de Manfred Gregor, le seul survivant des évènements racontés ici (1). C’est un film qui démontre l’absurdité de la guerre et, surtout, qui dénonce l’endoctrinement de la jeunesse. Tout d’abord, nous voyons évoluer ces adolescents dans leurs jeux, leur éveil à l’amour ; nous pouvons constater à quel point les exhortations à montrer sa valeur, son courage trouvaient là un terrain propice, les jeunes garçons ne pouvant s’empêcher d’idéaliser la guerre. Le jeu des acteurs est très naturel et donne une grande authenticité au film de Bernhard Wicki. La démonstration est terriblement efficace. Couvert de récompenses outre-Rhin, Le pont a été montré à toute une génération d’écoliers allemands.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Folker Bohnet, Fritz Wepper, Michael Hinz, Frank Glaubrecht
Voir la fiche du film et la filmographie de Bernhard Wicki sur le site IMDB.
Remarques :
* Le pont est l’un des premiers films allemands de l’Après-guerre à aborder directement la question de la guerre.
* Remake :
Die Brücke de Wolfgang Panzer (TV, 2008) qui semble généralement mal jugé par ceux qui l’ont vu car plus centré sur l’action.
(1) Dans la réalité, il n’y a eu que trois adolescents placés pour défendre Le pont. L’un d’entre eux, jugeant ce combat inutile et absurde, a déserté le soir même. Le lendemain, il a constaté que ses camarades étaient morts et qu’ils n’avaient, bien entendu, pas réussi à empêcher les américains de passer. C’est pour dénoncer l’endoctrinement de la jeunesse qu’il a décidé d’écrire (sous un pseudonyme) un roman, en étoffant l’histoire.