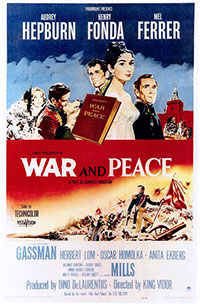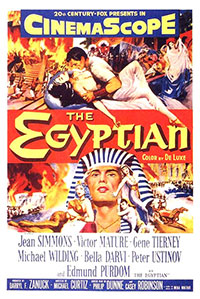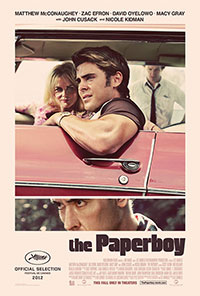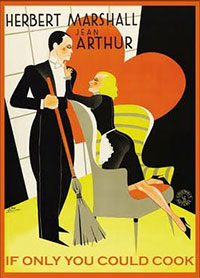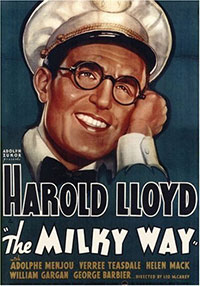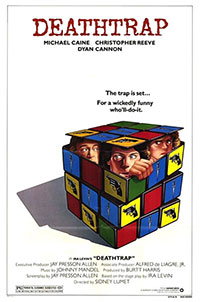Titre original : « The Crimson Pirate »
 A la fin du XVIIIe siècle, le pirate Vallo s’attaque à un navire officiel britannique lourdement armé. Il emporte un émissaire du roi pour aller mâter la révolution dans les Caraïbes…
A la fin du XVIIIe siècle, le pirate Vallo s’attaque à un navire officiel britannique lourdement armé. Il emporte un émissaire du roi pour aller mâter la révolution dans les Caraïbes…
Deux ans après La Flèche et le flambeau de Jacques Tourneur, la Warner reprend le principe d’un grand film d’aventures basé sur les qualités acrobatiques de Burt Lancaster et de Nick Cravat, son acolyte muet (1). La direction en est confiée à Robert Siodmak qui insiste pour donner un ton de comédie à cette histoire de pirates écrite par Roland Kibbee, Le Corsaire rouge. Ce mélange d’humour et d’aventures donne un caractère très particulier au film, certaines scènes (les poursuites notamment) étant très proches de la farce. Le film peut être qualifié de satirique car il parodie certains clichés des film de pirates. L’autre point particulier est la présence des « inventions » : on y voit ainsi un petit sous-marin, une mitraillette de fortune. Avec l’utilisation d’une montgolfière, l’ensemble fait penser au Baron de Münchhausen. A l’instar des films de Douglas Fairbanks (2), Le corsaire rouge dégage une grande vitalité et une énergie qui maintiennent le spectateur en haleine. Il n’y a pas beaucoup de temps morts… C’est un film très plaisant, un excellent divertissement visible à tous les âges.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Burt Lancaster, Nick Cravat, Eva Bartok, Leslie Bradley
Voir la fiche du film et la filmographie de Robert Siodmak sur le site IMDB.
Voir les autres films de Robert Siodmak chroniqués sur ce blog…
Remarques :
* Le film fut entièrement tourné en Europe : Espagne, Italie et Angleterre. Les scènes maritimes ont été tournées sur l’île d’Ischia, en face de Naples. Le budget initial fut largement dépassé.
* Dans Le Sens de la Vie des Mont Python, le nom de la compagnie d’assurances Crimson Permanent Assurance Compagnie (dont le building navigue entre les immeubles à la suite d’une mutinerie des employés) est une référence à ce film The Crimson Pirate.
* Le principe de marcher sous l’eau avec une barque retournée sur la tête (fournissant ainsi une réserve d’air) a été repris dans Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl (2003). La scène de l’équipage pirate suspendue dans un filet a été reprise dans Pirates des Caraïbes – Le secret du coffre maudit (2006).
 Nick Cravat et Burt Lancaster dans The Crimson Pirate de Robert Siodmak
Nick Cravat et Burt Lancaster dans The Crimson Pirate de Robert Siodmak
(1) Si le personnage de Nick Cravat est muet, c’est parce que l’acteur avait un fort accent de Brooklyn ce qui aurait été quelque peu incongru pour cette époque…
(2) D’ailleurs, au moins une scène (celle de l’attaque finale sous l’eau) figurait dans Le Pirate noir d’Albert Parker (1926), film avec Douglas Fairbanks et Billie Dove.