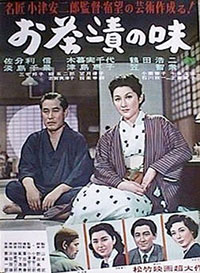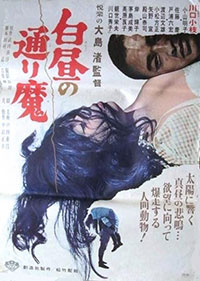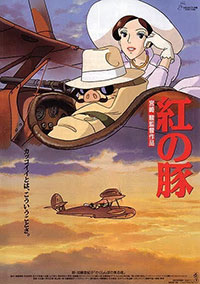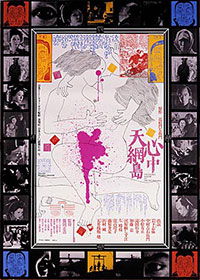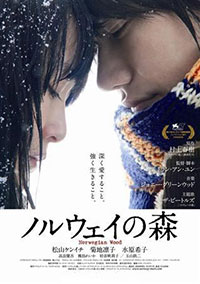Titre original : « Tôkyô boshoku »
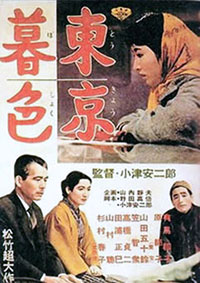 Un père vit seul avec ses deux filles depuis que sa femme l’a quitté vingt-cinq ans auparavant. L’aînée est mariée mais revient vivre chez son père avec son enfant après s’être disputé avec son mari. La plus jeune, toujours étudiante, est tombée amoureuse d’un garçon qui s’éloigne d’elle… Crépuscule à Tokyo voit Ozu faire une excursion dans le mélodrame. Nous retrouvons ici certains de ses thèmes récurrents, les conséquences du mariage arrangé, la place de la femme ou encore la difficulté de dialogues entre les générations, mais ils sont cette fois au service d’effets mélodramatiques que l’on peut juger trop appuyés ; c’est particulièrement manifeste lors du dénouement. Nous ne retrouvons pas ici cette profondeur dans les personnages à laquelle Ozu nous a habitués. L’ensemble est aussi inhabituellement noir. Beaucoup de commentateurs ont cru voir une réflexion sur la jeunesse mais cela parait difficilement être le cas. Toutefois, même s’il souffre de la comparaison avec ses autres films, Crépuscule à Tokyo ne manque de qualités, notamment dans sa forme.
Un père vit seul avec ses deux filles depuis que sa femme l’a quitté vingt-cinq ans auparavant. L’aînée est mariée mais revient vivre chez son père avec son enfant après s’être disputé avec son mari. La plus jeune, toujours étudiante, est tombée amoureuse d’un garçon qui s’éloigne d’elle… Crépuscule à Tokyo voit Ozu faire une excursion dans le mélodrame. Nous retrouvons ici certains de ses thèmes récurrents, les conséquences du mariage arrangé, la place de la femme ou encore la difficulté de dialogues entre les générations, mais ils sont cette fois au service d’effets mélodramatiques que l’on peut juger trop appuyés ; c’est particulièrement manifeste lors du dénouement. Nous ne retrouvons pas ici cette profondeur dans les personnages à laquelle Ozu nous a habitués. L’ensemble est aussi inhabituellement noir. Beaucoup de commentateurs ont cru voir une réflexion sur la jeunesse mais cela parait difficilement être le cas. Toutefois, même s’il souffre de la comparaison avec ses autres films, Crépuscule à Tokyo ne manque de qualités, notamment dans sa forme.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Setsuko Hara, Ineko Arima, Chishû Ryû, Isuzu Yamada, Teiji Takahashi, Haruko Sugimura
Voir la fiche du film et la filmographie de Yasujirô Ozu sur le site IMDB.
Voir les autres films de Yasujirô Ozu chroniqués sur ce blog… .