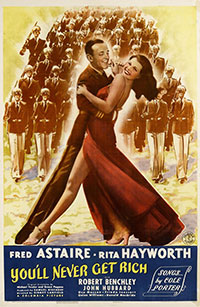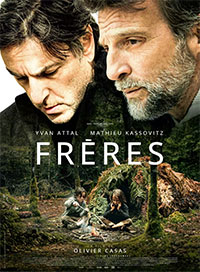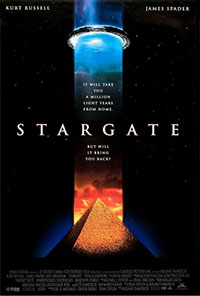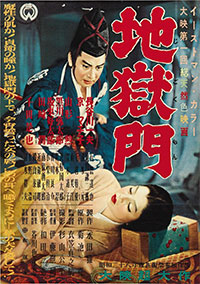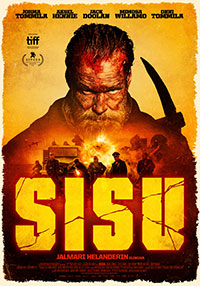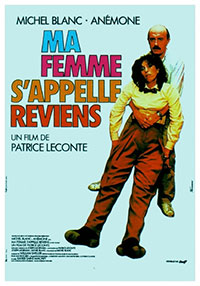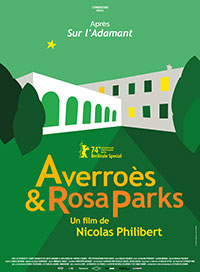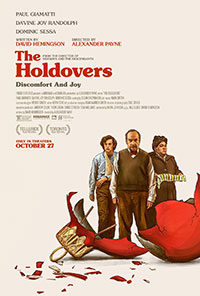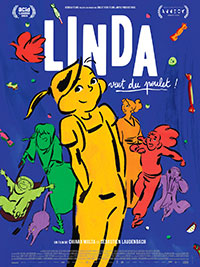Titre original : « Body of Lies »
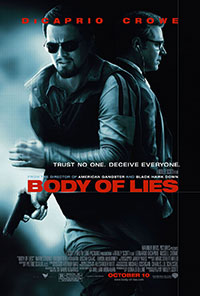 Ancien journaliste de guerre, Roger Ferris a été recruté par la CIA pour traquer l’un des leaders d’Al-Qaïda. Il reçoit ses ordres d’Ed Hoffman, chef de la division Moyen-Orient de la CIA, qui lui dicte ses ordres depuis sa villa de banlieue américaine, poursuivant en parallèle sa vie familiale tranquille d’Américain moyen. Il s’associe également avec le chef des services secrets jordaniens, dont il est difficile de gagner la confiance…
Ancien journaliste de guerre, Roger Ferris a été recruté par la CIA pour traquer l’un des leaders d’Al-Qaïda. Il reçoit ses ordres d’Ed Hoffman, chef de la division Moyen-Orient de la CIA, qui lui dicte ses ordres depuis sa villa de banlieue américaine, poursuivant en parallèle sa vie familiale tranquille d’Américain moyen. Il s’associe également avec le chef des services secrets jordaniens, dont il est difficile de gagner la confiance…
Mensonges d’État est un film d’espionnage américain réalisé par Ridley Scott. Le scénario a été écrit par William Monahan en s’inspirant d’un roman du journaliste David Ignatius. Il convient de replacer ce film dans son époque, post-11 septembre, alors que le chef du mouvement terroriste était toujours recherché. Le récit, dans le style de John Le Carré, mêle assez brillamment réalité et fiction mais on peut lui reprocher de trop respecter les conventions du genre. La réalisation est parfaitement maitrisée. Ridley Scott est expert pour filmer avec plusieurs caméras ce qui facilite l’immersion et la vitalité. Leonardo DiCaprio fait une bonne prestation. Le film n’a pas eu le succès attendu.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Ali Suliman
Voir la fiche du film et la filmographie de Ridley Scott sur le site IMDB.
Voir la fiche du film sur AlloCiné.
Voir les autres films de Ridley Scott chroniqués sur ce blog…
Voir les livres sur Ridley Scott…