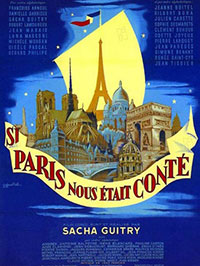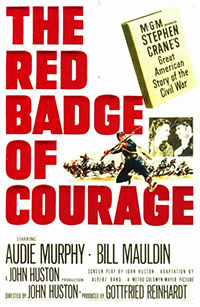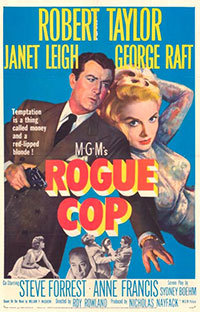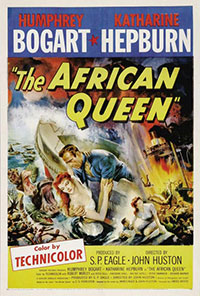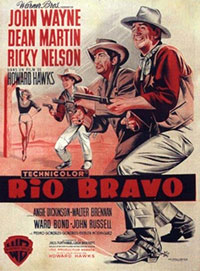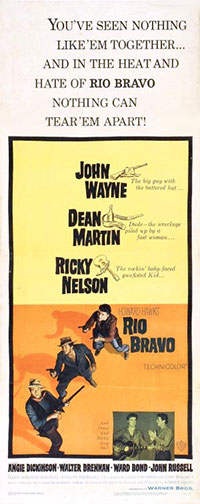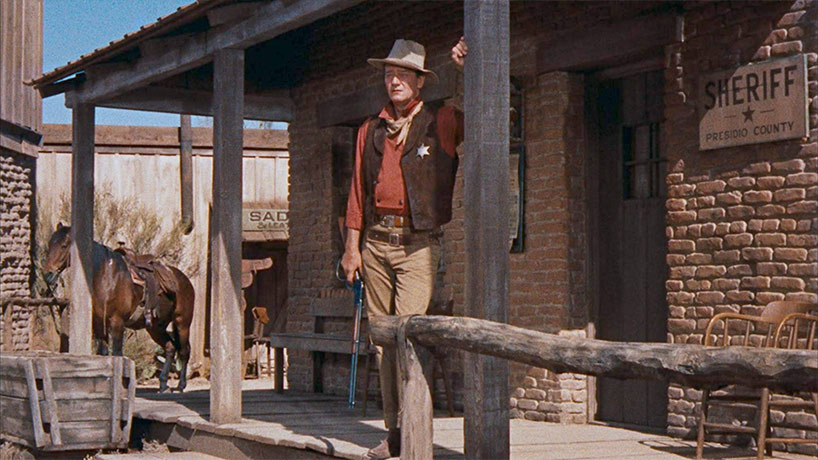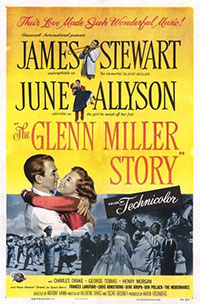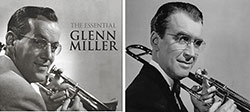Titre original : « The burglar »
 Un cambrioleur parvient avec ses complices à subtiliser un collier de grande valeur. Malheureusement pour lui, il a été vu par deux policiers en patrouille. Le cambrioleur préfère donc se cacher et d’attendre avant de revendre le collier mais ses complices sont plus impatients… Le cambrioleur est un film noir adapté d’un roman de David Goodis qui en a écrit lui-même l’adaptation. C’est le premier long métrage de Paul Wendkos. Grand admirateur d’Orson Welles, il en reprend l’audace : très inventif dans ses plans de caméra, parfois jusqu’à l’excès mais le plus souvent de façon fort réussie, il étonna la critique et même Columbia qui le prit sous contrat. Il fignola lui-même le montage, ce qui lui prit une année ; le résultat montre une certaine perfection. Le scénario, en revanche, est assez faible, l’histoire tournant rapidement en rond. A noter la belle interprétation de Dan Duryea et même de la jeune Jayne Mansfield : un personnage assez éloigné des rôles de plantureuse idiote dans lesquels elle sera ensuite cantonnée. Le cambrioleur reste assez peu connu, il est pourtant très inventif et original dans sa forme. Les films suivants de Paul Wendkos ne furent pas hélas au niveau de cet étonnant premier essai.
Un cambrioleur parvient avec ses complices à subtiliser un collier de grande valeur. Malheureusement pour lui, il a été vu par deux policiers en patrouille. Le cambrioleur préfère donc se cacher et d’attendre avant de revendre le collier mais ses complices sont plus impatients… Le cambrioleur est un film noir adapté d’un roman de David Goodis qui en a écrit lui-même l’adaptation. C’est le premier long métrage de Paul Wendkos. Grand admirateur d’Orson Welles, il en reprend l’audace : très inventif dans ses plans de caméra, parfois jusqu’à l’excès mais le plus souvent de façon fort réussie, il étonna la critique et même Columbia qui le prit sous contrat. Il fignola lui-même le montage, ce qui lui prit une année ; le résultat montre une certaine perfection. Le scénario, en revanche, est assez faible, l’histoire tournant rapidement en rond. A noter la belle interprétation de Dan Duryea et même de la jeune Jayne Mansfield : un personnage assez éloigné des rôles de plantureuse idiote dans lesquels elle sera ensuite cantonnée. Le cambrioleur reste assez peu connu, il est pourtant très inventif et original dans sa forme. Les films suivants de Paul Wendkos ne furent pas hélas au niveau de cet étonnant premier essai.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Dan Duryea, Jayne Mansfield, Martha Vickers, Peter Capell, Mickey Shaughnessy
Voir la fiche du film et la filmographie de Paul Wendkos sur le site IMDB.
Remake :
Le Casse d’Henri Verneuil (1971) avec Jean-Paul Belmondo.