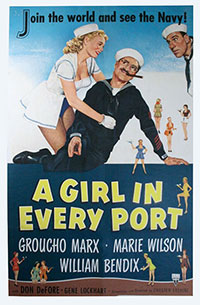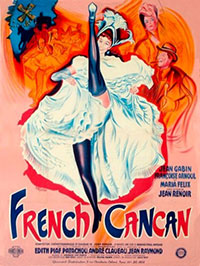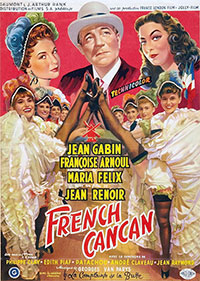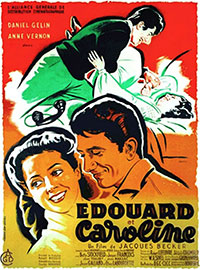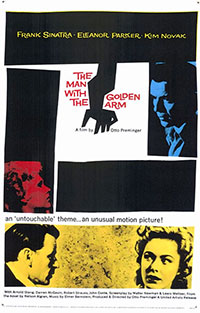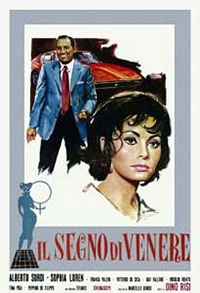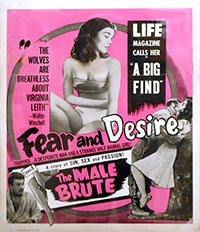Titre original : « Oyû-sama »
Autres titres français : « Mademoiselle Oyû », « Madame Oyû »
 Japon, fin de l’ère Meiji (1). Lorsque Shinnosuke est présenté à Shizu en vue d’un mariage, il est ébloui par sa soeur Oyû, plus âgée. Bien qu’elle soit veuve, les conventions empêchent toutefois cette dernière de se marier car elle reste liée à son défunt mari par l’enfant qu’ils ont eu ensemble… Miss Oyû est adapté d’un roman à succès des années trente de Jun’ichirô Tanizaki. Ce triangle amoureux est rendu très puissant par la force des sentiments et la mise en scène, belle et épurée de Mizoguchi. C’est essentiellement un double portrait de femme, le personnage masculin étant, comme souvent chez Mizoguchi, particulièrement faible : ce sont les femmes qui décident pour lui. Il recherche avant tout la mère qu’il n’a que très peu connue. Les personnalités d’Oyû et de sa jeune soeur sont bien plus développées, fortes sans être complexes. Mizoguchi filme avec une certaine épure, avec une caméra qui sait se faire mobile (travelings latéraux) quand il faut et des cadrages qui jouent avec la distance ou la proximité. Miss Oyû est souvent considéré comme mineur dans la filmographie de Mizoguchi mais cette alliance (tant recherchée par les cinéastes) de force et de simplicité rend ce film assez remarquable.
Japon, fin de l’ère Meiji (1). Lorsque Shinnosuke est présenté à Shizu en vue d’un mariage, il est ébloui par sa soeur Oyû, plus âgée. Bien qu’elle soit veuve, les conventions empêchent toutefois cette dernière de se marier car elle reste liée à son défunt mari par l’enfant qu’ils ont eu ensemble… Miss Oyû est adapté d’un roman à succès des années trente de Jun’ichirô Tanizaki. Ce triangle amoureux est rendu très puissant par la force des sentiments et la mise en scène, belle et épurée de Mizoguchi. C’est essentiellement un double portrait de femme, le personnage masculin étant, comme souvent chez Mizoguchi, particulièrement faible : ce sont les femmes qui décident pour lui. Il recherche avant tout la mère qu’il n’a que très peu connue. Les personnalités d’Oyû et de sa jeune soeur sont bien plus développées, fortes sans être complexes. Mizoguchi filme avec une certaine épure, avec une caméra qui sait se faire mobile (travelings latéraux) quand il faut et des cadrages qui jouent avec la distance ou la proximité. Miss Oyû est souvent considéré comme mineur dans la filmographie de Mizoguchi mais cette alliance (tant recherchée par les cinéastes) de force et de simplicité rend ce film assez remarquable.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Kinuyo Tanaka, Nobuko Otowa, Yûji Hori
Voir la fiche du film et la filmographie de Kenji Mizoguchi sur le site IMDB.
Voir les autres films de Kenji Mizoguchi chroniqués sur ce blog…
(1) L’ère Meiji est la période historique du Japon qui va de 1868 à 1912, sous le règne de l’Empereur Meiji. Cette période qui a vu l’ouverture du pays sur le monde extérieur est celle qui a le plus inspiré écrivains et cinéastes.