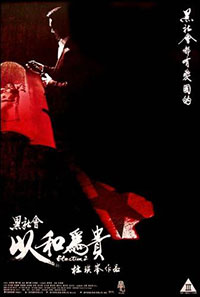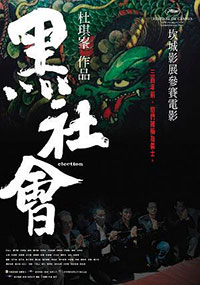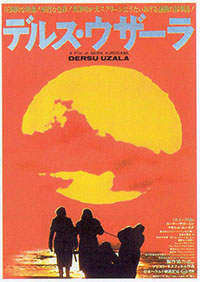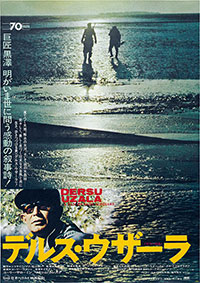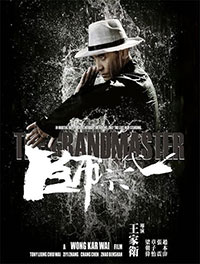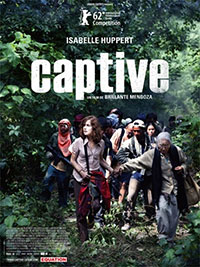Titre original : « Snowpiercer »
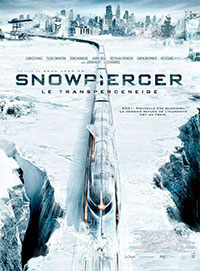 En répandant un gaz pour stopper le réchauffement climatique, l’homme a provoqué un nouvel âge glaciaire qui a éradiqué toute vie sur Terre. Seuls subsistent un petit millier de personnes dans un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans s’arrêter, et dans lequel une hiérarchie de classes s’est formée : alors qu’à l’avant, une minorité vit dans l’aisance, des centaines de gens sont entassés à l’arrière dans une misère extrême… Snowpiercer est l’adaptation de la bande dessinée française Le Transperceneige de Jean-Marc Rochette, Benjamin Legrand et Jacques Lob, parue en 1984. Il ne faut surtout pas chercher de vraisemblance dans cette histoire post-apocalyptique, les incohérences sont légion. Il faut plutôt la prendre comme une fable : le lieu restreint permet de créer un microcosme où les différences entre classes sociales sont poussées à l’extrême et où une révolte offre de nombreuses possibilités de scènes d’action (car le film regorge d’action et le sang coule abondamment). La métaphore reste assez grossière, le meilleur se situe certainement dans les décors : les extérieurs avec les villes saisis par le froid sont hélas trop rares mais à l’intérieur, chaque wagon traversé révèle un décor totalement différent et certains (l’aquarium par exemple) sont féériques. Le réalisateur coréen Joon-ho Bong n’a pas cherché à rendre les décors vraisemblables, il a gardé un esprit « bande dessinée ». Ce parti-pris lui permet également d’avoir une entière liberté dans les scènes : si la plupart des wagons sont simplement traversés et que d’autres ne sont que le théâtre d’interminables scènes d’action, quelques-uns offrent une scène inattendue : celle de l’école est une petite merveille. Malgré une diffusion plutôt limitée, Snowpiercer a été généralement très bien accueilli par la critique et le public. Il a le mérite d’être particulièrement original.
En répandant un gaz pour stopper le réchauffement climatique, l’homme a provoqué un nouvel âge glaciaire qui a éradiqué toute vie sur Terre. Seuls subsistent un petit millier de personnes dans un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans s’arrêter, et dans lequel une hiérarchie de classes s’est formée : alors qu’à l’avant, une minorité vit dans l’aisance, des centaines de gens sont entassés à l’arrière dans une misère extrême… Snowpiercer est l’adaptation de la bande dessinée française Le Transperceneige de Jean-Marc Rochette, Benjamin Legrand et Jacques Lob, parue en 1984. Il ne faut surtout pas chercher de vraisemblance dans cette histoire post-apocalyptique, les incohérences sont légion. Il faut plutôt la prendre comme une fable : le lieu restreint permet de créer un microcosme où les différences entre classes sociales sont poussées à l’extrême et où une révolte offre de nombreuses possibilités de scènes d’action (car le film regorge d’action et le sang coule abondamment). La métaphore reste assez grossière, le meilleur se situe certainement dans les décors : les extérieurs avec les villes saisis par le froid sont hélas trop rares mais à l’intérieur, chaque wagon traversé révèle un décor totalement différent et certains (l’aquarium par exemple) sont féériques. Le réalisateur coréen Joon-ho Bong n’a pas cherché à rendre les décors vraisemblables, il a gardé un esprit « bande dessinée ». Ce parti-pris lui permet également d’avoir une entière liberté dans les scènes : si la plupart des wagons sont simplement traversés et que d’autres ne sont que le théâtre d’interminables scènes d’action, quelques-uns offrent une scène inattendue : celle de l’école est une petite merveille. Malgré une diffusion plutôt limitée, Snowpiercer a été généralement très bien accueilli par la critique et le public. Il a le mérite d’être particulièrement original.
Elle: –
Lui : ![]()
Acteurs: Chris Evans, Song Kang-ho, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell
Voir la fiche du film et la filmographie de Bong Joon-ho sur le site IMDB.
Voir la fiche du film sur AlloCiné.
Voir les autres films de Bong Joon-ho chroniqués sur ce blog…

Chris Evans et Song Kang-ho dans Snowpiercer – le Transperceneige de Bong Joon Ho.