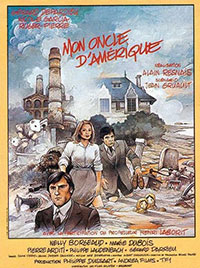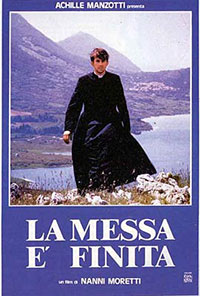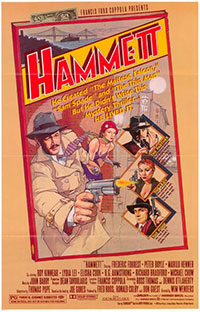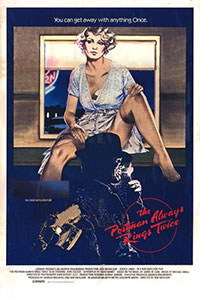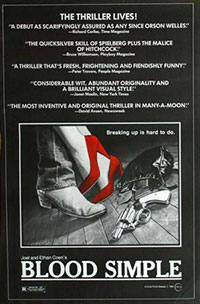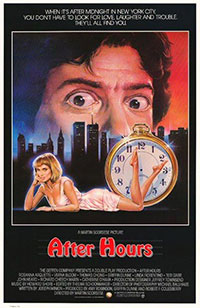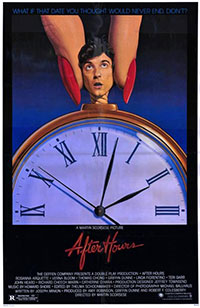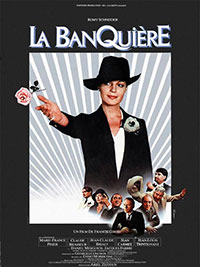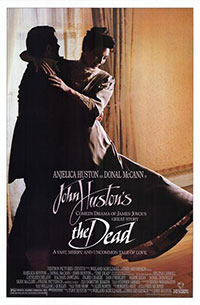Titre original : « Moonlighting »
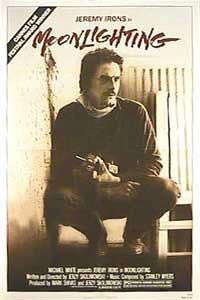 Trois ouvriers et un contremaître arrivent de Varsovie à Londres pour refaire à neuf le pied-à-terre de leur patron polonais. Ils ont un mois pour le faire. Seul Nowak, le contremaître, parle anglais. Un jour, il découvre que les lignes téléphoniques avec la Pologne sont coupées… Pour attirer l’attention sur l’état d’urgence décrété en son pays (1), le polonais Jerzy Skolimowski fait un film très original, à plusieurs niveaux de lecture. Le volet politique n’est pas le plus proéminent dans Travail au noir même s’il est bel et bien là, pesant de tout son poids sur l’évolution de l’histoire. L’action se passe d’ailleurs à Londres et non à Varsovie. C’est plutôt l’observation de ce petit groupe, isolé, presque coupé du monde, où le contremaître Nowak est le seul à pouvoir raisonner, sa position sociale étant renforcée par sa faculté à maitriser l’anglais et donc à communiquer avec le monde extérieur. Il va devoir aller nettement au-delà de ses seules prérogatives, ses trois ouvriers lui étant de fait livrés corps et âme, il va se comporter de façon despotique. Quelle belle allégorie. C’est aussi un film qui montre les petites mesquineries de la société anglaise, faisant preuve d’un certain humour sur ce point. Travail au noir fut réalisé très rapidement (écrit en onze jours et tourné en vingt-trois jours) (2) mais cela ne l’empêche pas d’être un film assez fort, finalement assez complexe, une approche très originale des évènements qui se déroulaient alors en Pologne, mêlant habilement humour et drame ; c’est l’un des films qui ont marqué le début des années quatre vingt.
Trois ouvriers et un contremaître arrivent de Varsovie à Londres pour refaire à neuf le pied-à-terre de leur patron polonais. Ils ont un mois pour le faire. Seul Nowak, le contremaître, parle anglais. Un jour, il découvre que les lignes téléphoniques avec la Pologne sont coupées… Pour attirer l’attention sur l’état d’urgence décrété en son pays (1), le polonais Jerzy Skolimowski fait un film très original, à plusieurs niveaux de lecture. Le volet politique n’est pas le plus proéminent dans Travail au noir même s’il est bel et bien là, pesant de tout son poids sur l’évolution de l’histoire. L’action se passe d’ailleurs à Londres et non à Varsovie. C’est plutôt l’observation de ce petit groupe, isolé, presque coupé du monde, où le contremaître Nowak est le seul à pouvoir raisonner, sa position sociale étant renforcée par sa faculté à maitriser l’anglais et donc à communiquer avec le monde extérieur. Il va devoir aller nettement au-delà de ses seules prérogatives, ses trois ouvriers lui étant de fait livrés corps et âme, il va se comporter de façon despotique. Quelle belle allégorie. C’est aussi un film qui montre les petites mesquineries de la société anglaise, faisant preuve d’un certain humour sur ce point. Travail au noir fut réalisé très rapidement (écrit en onze jours et tourné en vingt-trois jours) (2) mais cela ne l’empêche pas d’être un film assez fort, finalement assez complexe, une approche très originale des évènements qui se déroulaient alors en Pologne, mêlant habilement humour et drame ; c’est l’un des films qui ont marqué le début des années quatre vingt.
Elle: ![]()
Lui : ![]()
Acteurs: Jeremy Irons, Eugene Lipinski, Jirí Stanislav
Voir la fiche du film et la filmographie de Jerzy Skolimowski sur le site IMDB.
Voir les autres films de Jerzy Skolimowski chroniqués sur ce blog…
(1) En décembre 1981, face à la montée du syndicat Solidarność et par crainte d’une intervention militaire soviétique en Pologne, le premier ministre le général Jaruzelski déclare la loi martiale. Couvre-feu, arrestation des opposants, grèves brutalement réprimées, l’état de siège durera jusqu’en juillet 1983. Jaruzelski restera au pouvoir jusqu’en 1990, laissant la place à Lech Walesa, fondateur de Solidarność. On sait, depuis l’ouverture des archives soviétiques, que l’URSS n’avait pas l’intention d’intervenir en Pologne. Le général Jaruzelski a été inculpé en 2007 de « crime communiste » pour avoir instauré la loi martiale en 1981.
(2) Travail au noir fut présenté à Cannes en mai 1982, soit seulement cinq mois après l’instauration de la loi martiale en Pologne.
Lire aussi : une bonne analyse du film par Olivier Bitoun sur DVDClassik …