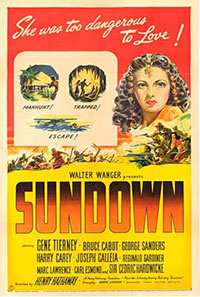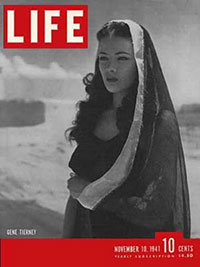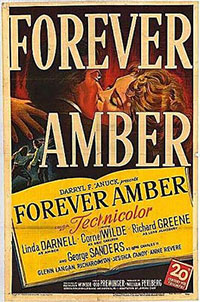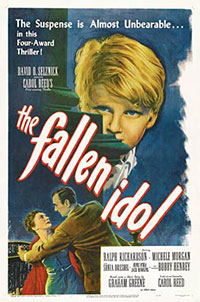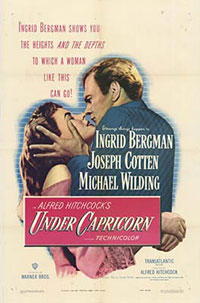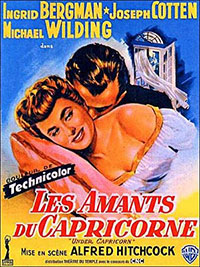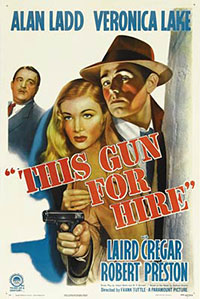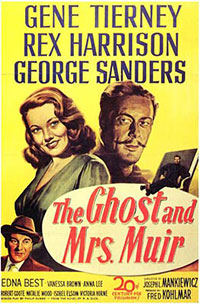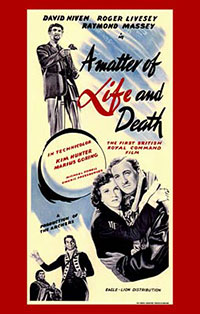Lui :
Le film de Jacques de Baroncelli est généralement considéré comme étant la meilleure des adaptations du roman d’Eugène Sue Les Mystères de Paris. Transformer un roman de plus de 1000 pages, particulièrement riche en évènements, en un film de 90 minutes n’est pas une tâche facile mais Maurice Bessy y parvient. L’histoire se place au début du XIXe siècle : une jeune fille, Fleur de Marie, est arrachée à un sombre tripot des bas-fonds de Paris par un mystérieux bienfaiteur… Jacques de Baroncelli est un réalisateur prolixe qui n’en est pas à sa première adaptation littéraire. Il tourne Les Mystères de Paris sous l’Occupation mais rien ne semble montrer qu’il ait manqué de moyens. L’interprétation des premiers rôles est remarquable, avec des acteurs qui viennent du monde du théâtre et qui jouent très juste : Marcel Herrand (qui pour une fois a le beau rôle), Alexandre Rignault (« le Maître d’école »), Lucien Coëdel (« le Chourineur ») et Germaine Kerjean, de l’Académie Française, méconnaissable sous son maquillage terrifiant, assez mémorable dans son interprétation de « la Chouette ». En revanche, Fleur de Marie et certains petits rôles ne bénéficient pas d’une telle qualité, sans toutefois gâter l’ensemble. L’histoire est poignante et garde quelques-uns des nombreux rebondissements du roman. Une belle adaptation.
Note : ![]()
Acteurs: Marcel Herrand, Alexandre Rignault, Lucien Coëdel, Albert Gercourt, Yolande Laffon, Cécilia Paroldi, Roland Toutain
Voir la fiche du film et la filmographie de Jacques de Baroncelli sur le site IMDB.
Remarque :
Jacques de Baroncelli est le père de Jean de Baroncelli (décédé en 1998), critique de cinéma au journal Le Monde qui fit aussi les grandes heures du Masque et la Plume…
Adaptations des Mystères de Paris d’Eugène Sue à l’écran (grand et petit) :
Les Mystères de Paris (1909) par Victorin-Hippolyte Jasset
Les Mystères de Paris (1911) par Albert Capellani
The Mysteries of Paris (1920) de l’américain Ed Cornell
Les Mystères de Paris (1922) par Charles Burguet avec Huguette Duflos et Georges Lannes
The Secrets of Paris (1922) de l’américain Kenneth S. Webb avec Lew Cody
Les Mystères de Paris (1935) de Félix Gandéra avec Madeleine Ozeray et Lucien Baroux
Les Mystères de Paris (1943) de Jacques de Baroncelli (cette version)
Les Mystères de Paris (1957) de l’italien Fernando Cerchio avec Franck Villard
Les Mystères de Paris (1961) de Marcel Cravenne (TV) adaptation Claude Santelli
Les Mystères de Paris (1962) de André Hunebelle avec Jean Marais
Les Mystères de Paris (1980) de André Michel (série TV)