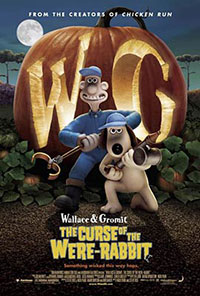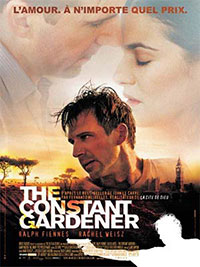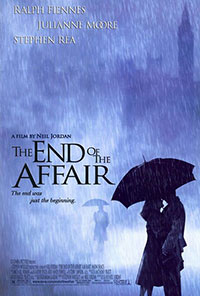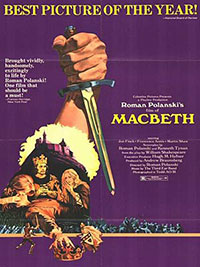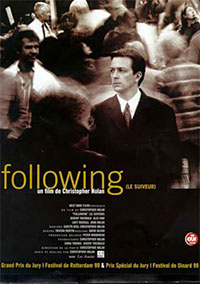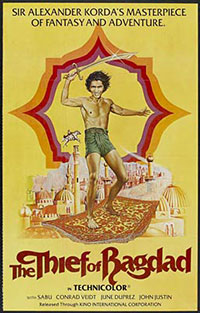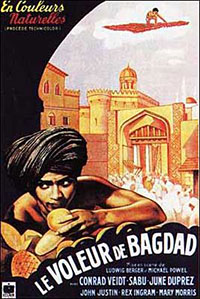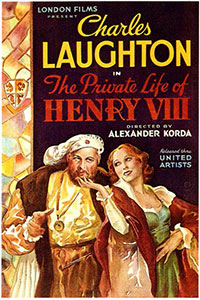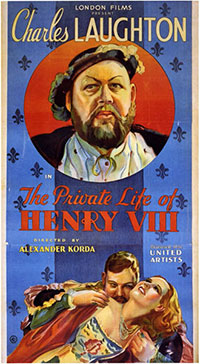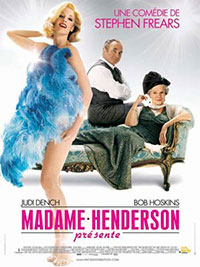Titre original : « Pride & prejudice »
 Elle :
Elle :
Une fresque somptueuse au cœur de la haute bourgeoisie britannique dans laquelle sont développés les thèmes de l’amour, l’hypocrisie sociale, la place et l’émancipation des femmes. Keira Knightley incarne le rôle d’Elisabeth la rebelle de façon lumineuse. Cette femme est le pivot central du film et porte le regard de Jane Austen. Quatre autres soeurs à marier, une mère presque entremetteuse, un père effacé et un Darcy amoureux bien énigmatique. Tels sont les personnages qui gravitent autour d’elle. Partagée entre les contradictions, elle a à la fois envie de les protéger, de perpétrer la notion de famille mais aussi une folle envie d’aimer et de s’émanciper. Le film est riche visuellement et les portraits psychologiques des personnages sont sensibles et profonds. On passe un très bon moment.
Note : 
Lui :
Orgueil et préjugés, ce grand roman de Jane Austen, a déjà été adapté plusieurs fois à l’écran (grand et petit). Cette version anglo-française se révèle tout à fait à la hauteur pour exprimer la force de ce roman qui traite de la recherche de l’amour et du mariage tout en offrant une certaine vision de la société anglaise de l’époque, engoncée dans ses principes et reposant sur une hiérarchisation sociale très marquée. La jeune Keira Knightley fait là une très belle prestation, très classique dans son interprétation avec un petit côté garçon manqué qui convient parfaitement à son personnage de jeune fille un peu rebelle. La reconstitution est bien réalisée, bien intégrée et assez réaliste. Le film dans son ensemble est très plaisant. Une réussite.
Note : 
Acteurs: Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Rosamund Pike, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Simon Woods, Judi Dench
Voir la fiche du film et la filmographie de Joe Wright sur le site imdb.com.
Autres versions :
Orgueil et préjugés de Robert Z. Leonard (1940) avec Laurence Olivier et Greer Garson
Orgueil et préjugés de Andrew Black (2003) avec Kam Heskin
Orgueil et préjugés de Simon Langton (1995) (TV) avec Colin Firth et Jennifer Ehle
+ de nombreuses versions TV.
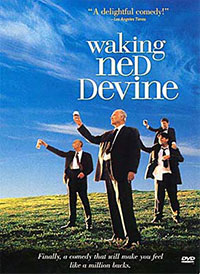 Elle :
Elle :![]()
![]()